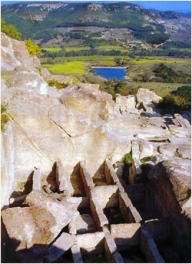Les
Thraces
par
Daniel Milev
L'écriture
de cet article a été interrompue suite à la mise
en surveillance de mon domicile. Lire
l'article afférent.
Dernière
mise à jour : le 30 novembre 2008
Introduction
- l'ombre mortifiante de la Grèce Antique
Nous
avons tous été conditionnés pendant de longues
années par des phrases toutes prêtes, visant à
parfaire notre culture générale, souvent du genre :
"La Grèce est le berceau de la civilisation européenne".
Pourtant, l'Europe a connu d'autres civilisations, plus anciennes que
celle de la Grèce Antique et qui ont marqué d'une
manière, aujourd'hui largement ignorée, son histoire et
sa culture. Beaucoup connaissent celle de Crète, qui s'est
épanouie entre le 3e et le 2e millénaire, avant
et après l'arrivée des premiers Ioniens et des
Achéens (environs 2000 ans av. J.-C.). Cependant, jusqu'à
il y a trente ans, très peu de spécialistes connaissaient
véritablement la civilisation thrace, ancienne elle aussi de
plusieurs millénaires et précédant l'installation
des Grecs dans les Balkans. A la différence de ces derniers, qui
ont hérité de la civilisation minoenne, les Thraces
étaient les créateurs d'une civilisation originale et
héritiers d'une autre civilisation des Balkans, plus ancienne
encore - antérieure en effet à l'Egypte et à la
Mésopotamie, et qui restent toutes les deux toujours très
mal connues du grand public, notamment en Europe occidentale.
L'existence de toutes ces civilisations qui ont
précédé de quelques millénaires le monde
hellénique soulève pertinemment la question du rôle
qu'elles ont joué pour l'émergence de la Grèce
Antique. Question importante dans la mesure où elle
révèlera que les Grecs n'auraient sans doute jamais
été ce qu'ils sont devenus sans avoir été
au contact des anciennes civilisations des Balkans, du proche Orient et
du Nord de l'Afrique, notamment l'Egypte. Une fois de plus, c'est le
rôle que joue le milieu qui se révèle
prépondérant, même si certains
préfèrent ne pas voir les choses ainsi
! Malheureusement, c'est une question qui semble être
épineuse, car elle bousculera le lobbysme démesuré
en faveur d'un peuple à la fibre patriotique qui ne supporte
aucune remise en doute de son passé, et que peu de gens de toute
façon sont enclins à soulever volontiers de nos jours !
Les Grecs ont emprunté leur alphabet aux Phéniciens. Aux
Egyptiens, ils doivent la quasi totalité de leur
divinités, comme l'a démontré Hérodote. Qui
sait de nos jours, par exemple, que Dionysos(Zagreus) était un
dieu du vin thrace et que son culte à mystères largement
pratiqué en terre thrace a donné, en Grèce,
naissance à la comédie et à la tragédie,
bref au théâtre ? Il en est de même de la
connaissance de la géométrie et des maths. Thalès
de Millet était allé s'installer en Egypte
spécialement pour les y étudier. Pythagore connaissait la
totalité des œuvres d'Orphée par cœur. A l'époque,
c'était un moyen de faire de la vulgarisation de connaissances,
de diverses doctrines, en créant des poèmes que l'on
récitait devant un auditoire, car 95% des gens ne savaient ni
lire ni écrire et le savoir se transmettait par la tradition
orale essentiellement. Le mot grec "didaktikos" désignait
justement une poésie exposant une doctrine ou des connaissances
scientifiques, etc. Qui se souvient encore qu'Orphée
était un poète et musicien thrace, du moins selon les
Grecs, mais qui, dans la mythologie thrace, était un
prêtre-sorcier doué de pouvoirs surnaturels et qui est
à la base du culte de l'orphisme, et des "mystères" ?
Orphée a vécu environ 1200 ans avant notre ère.
Bien avant Bouddha, Zarathushtra et le Christ, il prônait :
"Connais-toi toi-même et tu connaîtra l'Univers et les
Dieux !" Formule extrêmement importante, car elle affirme
l'existance de toute la connaissance, voire de la science, qui
intéresse l'Homme, au fond de lui et qu'il n'a qu'à
la chercher en lui-même. De cette manière, il
s'affranchit de toute idéologie spéculative et rejette
tout pouvoir sur lui. Cela se transformera en un enjeu capital dans la
lutte entre ceux qui souhaitent dominer les gens, et le monde, par le
pouvoir qu'ils exerceront sur eux, et ceux qui voudront s'affranchir
de ce pouvoir. Les premiers justifieront leur pouvoir par une origine
divine, les autres diront que le divin est en chacun de nous et que
nous n'avons qu'à le découvrir. Plusieurs siècles
plus tard le Bouddhisme reprendra à sa façon la rechrche
de la connaissance de soi. Les Grecs copieront ce principe, mais le
transformeront dans le but de falsifier le message de la manière
suivante : "Connais-toi toi-même, laisse le monde aux Dieux !"
C'est l'inscription sur le fronton du Temple de Delphes. Cela rend le
message complètement contradictoire, car il donne l'impression
de reprendre une ancienne formule qui était juste et vraie, se
connaître, donc réfléchir à soi, à sa
condition, atteindre de cette manière la maîtrise de soi
et s'affranchir de l'emprise idéologique, mais en
réalité, il interdit la liberté aux gens de
décider, car c'est l'affaire des Dieux. De plus, les
prêtres eux-mêmes incitaient les gens à satisfaire
les Dieux, par des offrandes et des sacrifices. Conscient de cette
tentative de soumettre les gens par la religion d'Etat, qui
était devenue un moyen de manipulation entre les mains des
autorités grecques, Socrate reprit la formule de cette
inscription en ne gardant que la première partie et en faisant
rétablir ainsi la vérité et la justice. Pour lui,
apprendre à se connaître était également un
moyen de se sentir heureux, car l'homme qui connais son ignorance et
ses propres limites ne perdera pas de temps en cherchant à
obtenir des choses qui ne sont pas à sa portée, ce qui
le renderait malheureux. Il paiera de sa vie ses vues trop en
contradiction avec les normes établies dans la
société grecque de l'époque, accusé de
faire appel à un autre Dieu - la "raison", et de corrompre la
jeunesse, il a été "démocratiquement"
condamné à la mort. En acceptant de boire la ciguë,
c'est lui qui condamna moralement ses concitoyens "démocrates".
Le sort de bien d'autres philosophes fut similaire. Protagoras, qui
avait écrit: "Pour ce qui est des dieux, je n'ai aucune
possibilité de savoir s'ils existent, ni s'ils n'existent pas",
évita de boire la ciguë en s'enfuyant de Grèce.
Xénophon fut condamné à l'exil. Platon fut
menacé de mort et vendu au marché aux esclaves.
Racheté par ses admirateurs, il revint à Athènes,
fonda l'Académie et fit de la politique. Ce n'est pas un
hasard si le sophisme est apparu dans le monde antique grec,
c'était un moyen très commode pour une minorité
de toujours imposer ses points de vue à la majorité et
nous en faisons les frais même aujourd'hui au quotidien. Les
Grecs ont systématiquement emprunté des choses aux
autres peuples et les ont consciencieusement modifiées à
leur convenance. Dans certains cas on peut parler d'un travail de
synthèse, car ils ont su véritablement faire
évoluer le savoir qu'ils avaient acquis de par le monde, mais
dans bien d'autres cas, il s'agit d'une falsification volontaire et
préméditée. La force du "miracle" de la
Grèce Antique est due à l'incroyable "flair" qu'avaient
les Grecs pour dénicher partout dans le monde antique des choses
qui pouvaient servir leur cause et les transformer de sorte à
faire croire qu'ils en étaient les créateurs. De nos
jours, on appelerait cela du plagiat, dans l'Antiquité
c'était normal. Et les Grecs étaient passés
maîtres dans cet art. Ainsi, par exemple, la soit-disante
"mythologie grecque" n'est rien d'autre qu'une
récupération de légendes ayant appartenu
à d'autres peuples, plus anciens, et qui ont été
censurées et réecrites à leur manière par
les anciens Grecs.
Mais
comment se fait-il que les
Thraces aient pu rester si longtemps à l'ombre de la
Grèce Antique sans être connus à la quasi
totalité des européens de nos jours ? Les raisons en sont
historiques et très complexes. Une d'entre elles est le
désir des pays occidentaux de justifier leur politique de
colonisation. En se plaçant comme les héritiers directs
de la civilisation grecque et romaine, ils croyaient pouvoir tirer
argument du fait de "civiliser" les populations indigènes dans
les pays conquis, exactement comme le faisait les Romains. Ainsi, par
exemple, en France on évitait de parler des Gaulois au 16e -17e
siècle ou on minimisait leur apport à la formation du
peuple français pour mettre en relief l'héritage romain
et se valoriser exclusivement à travers celui qui s'est
montré le plus fort sur le champ de bataille. Les Rois de France
s'identifiaient à Auguste et à César. On
reprochait de cette façon inconsciemment l'échec des
Gaulois face aux Romains, ce qui les range du côté des
perdants, mais cela a induit un véritable complexe
d'infériorité chez les auteurs français qui,
durant des siècles, se complaisent à décrire les
"barbares" en dehors du monde des Romains comme de vrais sauvages, et
les Gaulois n'y échappaient pas. "Les mœurs des Gaulois au
temps de César étaient la barbarie même..."
(Encyclopédie de D'Alembert et Diderot). C'est une erreur
tellement fondamentale, d'autant plus que les Gaulois, à l'image
des Thraces, possédaient une culture et surtout une
spiritualité tout à fait remarquables, que l'on peut
sérieusement se demander est-ce que dans leur état
complexé les Français n'ont pas oublié de se
comporter en Hommes civilisés et d'être capables
d'apprécier à sa juste valeur l'héritage de leurs
aïeux ? Tout ce dénigrement avait pour seul but de se
valoriser en se plaçant comme les seules légitimes
héritiers de l'Empire Romain et comme les porteurs de la
civilisation à travers le monde entier. Il faut dire aussi
que le désir de gagner de nouveaux territoires aux
dépends de l'Empire Ottoman morribond("l'homme malade de
l'Europe") et la nécessité d'une justification de
l'intervention armée pour la libération de la
Grèce(1827), survenue un peu par la force des choses,
amenèrent la France à prendre dans la foulée
l'Algérie(1830-1857), et la Tunisie(1881-1883) et
soulevèrent la question du rôle de la Grèce
Antique dans la constitution de la civilisation européenne.
Par ailleurs, la France et l'Angleterre manquèrent pour
peu de se déclarer la guerre à cause de l'Egypte(1840).
La Grèce Antique joua également le rôle d'un
"refuge" pour montrer l'ancienneté de la civilisation
européenne et par conséquent sa
"supériorité" face à l'ombre menaçante
projeté par un certain sphynx au nez épaté,
mais brisé, le nez d'un pharaon noir nommé
Hufu(Chéops), qui pourrait contredire cette prétention
et faire éclater au grand jour le mensonge. Ainsi, lorsque la
Bulgarie fut libérée du joug Ottoman en 1878, et que
les premiers vestiges de la civilisation thrace furent mis à
jour, très peu de personnes se rendirent compte que les Thraces
n'étaient pas de simples barbares qui vivaient autrefois au nord
de la Grèce Antique. Mais, la raison principale de cet
état de fait incombe sans aucun conteste aux anciens Grecs
eux-mêmes. Depuis l'époque antique déjà, ils
avaient commencé consciencieusement et méthodiquement
à falsifier l'histoire et à minimiser l'apport culturel
des autres peuples, dont les Thraces, pour mettre en relief leur propre
creuset culturel dans lequel ils avaient savamment mêlangé
ce qu'ils avaient pris aux autres. La Grèce ayant
été libérée un siècle plus tôt
que la Bulgarie du joug ottoman, elle en a profité pour
renforcer son prestige aux dépends de la vérité
historique et surtout en enlevant à d'autres peuples ce qu'ils
pouvaient revendiquer comme étant leur propre héritage
et apport culturel dans la civilisation européenne. Dans cet
exercice de plagiat historique, les auteurs anglais, véritables
chantres de la Grèce Antique, ont donné leur contribution
immense !
Toutefois,
cet article ne vise pas à établir une table de
comparaison entre la culture grecque et la culture thrace. Il ne fait
aujourd'hui aucun doute que les deux ont largement emprunté
mutuellement les unes les autres en s'enrichissant, et pas comme
certains voudraient bien faire croire que les transferts de savoirs, de
techniques, de savoir-faire, se sont toujours effectués en sens
unique, que les uns étaient barbares, et les autres
civilisés. Nous parlerons ici exclusivement des trouvailles
archéologiques effectuées en Bulgarie,
mais qui n'était qu'une aire restrainte habitée jadis par
le peuple le plus nombreux du monde, après les Indous, si l'on
en croit Hérodote - les Thraces.
La
première civilisation européenne

|
| La
tombe №43 révèle un homme de taille 1,70m tenant un
sceptre composé d'une hache en pierre et dont le manche en
bois était plaqué de canules en or, symbole de son
prestige et de son pouvoir. |
La
découverte, à partir de 1972, de la nécropole de
Varna, au Nord-Est de
la Bulgarie,
bord de mer Noire, a constitué un évènement
majeur dans l'archéologie mondiale du siècle
passé.
Imaginez, c'était au 5e millénaire, en Europe occidentale
on érigeait des mégalites en pierre monumentaux, preuve
du début de la hiérarchisation des sociétés
agricoles qui s'épanouissaient et se structuraient ! Un
processus
similaire se produisait en Europe du Sud-Est au même moment,
cependant, ici il n'y avait point de monuments mégalitiques, les
tombes révélaient, à l'étonnement
général, des objets en or et en cuivre ! La
première orfèvrerie de l'humanité, dans
l'état actuel de nos connaissances, il y a 7000 ans ! Sur
près de 300 tombes fouillées, on a mis à jour 3020
objets en or d'un poids total supérieur à 6 kilogrammes
et dont la variété est grande. On peut diviser les objets
en 38 types essentiels dont les plus nombreux sont les perles de
verroterie, les applications et les anneaux. Tout comme
dans les sociétés mégalitiques, ces objets furent
la marque d'appartenance à une certaine aristocratie et d'une
hiérarchisation de la société néolitique.
Avant même l'Egypte et la Mésopotamie, cette civilisation
semblait posséder tous les atouts pour s'épanouir comme
une grande civilisation historique : échanges économiques
avec des régions éloignées à des centaines
de kilomètres, des prémices d'une écriture (signes
et pictogrammes qui rappellent les écritures
hiéroglyphiques crétoises et hittites, mais
antérieures de quelques siècles), exploitation
minière, sanctuaires, société structurée...
Des évènements catastrophiques d'une échelle
importante allaient en décider autrement. La civilisation
s'effondre brusquement, mais une partie de la population autochtone
continue d'occuper le territoire de l'actuelle Bulgarie
et de la Roumanie du sud de façon continue des siècles
durant, jusqu'à faire émerger, grâce à de
nouveaux arrivants, vers le 4e millénaire la population thrace.
Le
Déluge de la mer Noire
Il
y a plus de 7500 ans, la mer Noire était le plus grand lac d'eau
douce
au monde. Elle était séparée des eaux de la
Méditerrannée par une étroite bande de terre(un
isthme) - le
Bosphore. Lors de la dernière période de
déglaciation, les eaux de la Méditerrannée
gonflèrent et s'élevèrent suffisamment pour passer
par-dessus l'obstacle naturel et entamer une chute de plus de 120
mètres en effritant l'obstacle progressivement. L'eau
s'écoulait à cent kilomètres à l'heure et
le bruit de la chute - 200 fois celles du Niagara ! - était
audible à des centaines de kilomètres à la ronde.
Un évènement d'une telle ampleur ne pouvait pas passer
inaperçu pour les habitants du bord du lac autour duquel ils
avaient su développer l'agriculture et l'irrigation. Ces
agriculteurs étaient venus du Proche Orient quelques
millénaires plus tôt. Ici ils ont su élaborer des
techniques d'irrigation et des outils agricols essentiels qu'ils
allaient propager par la suite dans le reste du monde. En l'espace de
un ou deux ans, les eaux recouvrent près de 100 000 km².
L'eau salée de la Méditerrannée passe initialement
par-dessus l'eau douce et ensuite submerge étant plus lourde en
tuant presque toute vie d'eau douce. C'est la création de la mer
de la Mort ou la mer Noire. Des légendes racontant des
évènement similaires deviendront un jour la base du mythe
du Déluge. Le plus ancien texte qui nous est parvenu à ce
jour relatant des innondations catastrophiques date du 2e
millénaire et a été écrit au Proche Orient.
Ce texte est devenu la base du récit byblique du Déluge.
Peut-être une partie des agriculteurs ont migré alors de
nouveau vers le Porche Orient. Toutefois, il est difficile de mettre en
relation l'évènement catasrophique et la propagation en
Europe de l'agriculture, car il existe un décalage dans le temps
très important entre les deux évènements.
Des montées des eaux plus ou moins importantes ont
continué
à avoir lieu jusqu'à l'Antiquité. Les habitants de
la plus ancienne civilisation d'Europe semblent avoir quitté
subitement leurs maisons en prenant le plus nécessaire et
parfois en
incendiant volontairement leurs demeures. Des villages lacustres
engloutis par les
eaux dans le lac de Varna témoignent que la fin de cette
civilisation a eu lieu probalement suite à une montée
plus
importante et intempestive des eaux environ 3800 ans av. J.-C. Des
villages lacustres similaires ont été découverts
dans les Alpes en Suissse, en Allemagne et en France.
Peut-il y avoir une continuité entre la civilisation de Varna et
celles
de la Mésopotamie ? Beaucoup de chercheurs se sont posés
cette
question déjà, mais pour l'heure la plupart rejettent une
telle possibilité à cause de la grande distance de
plusieurs siècles entre la disparition de l'une et les
débuts des autres. Pour réussir à défendre
une telle thèse, il faudra trouver une civilisation
"intermédiaire"
ou "transmettrice", qui assure le lien entre les deux régions. A
l'heure
actuelle,
cette époque du passé garde jalousement ses secrets.
Le
peuple le plus nombreux d'Europe
Les Thraces étaient un amalgame de diverses populations, qui
furent
assilmilées progressivement. C'étaient des cavaliers, des
guerriers et des artisans remarquables. Ils étaient des
vignerons fameux et adoraient le vin pour lequel ils organisaient les
fêtes de Dionysos. A la différence des Grecs et plus tard
des Romains, les Thraces ne diluaient pas leur vin avec de l'eau et aux
yeux de leurs contemporains, ils passaient pour des ivrognes. On
considère que les peuples thraces se sont formés au
milieu du 4e millénaire lorsque des groupes en provenance des
terres à l'est de la Volga se sont installés dans les
Balkans. Quelques rares auteurs
émettent l'hypothèse qu'ils sont arrivés de l'Asie
Centrale. Les Thraces avaient une population très dense et des
villes occupant le territoire de manière compacte.
Hérodote disait d'eux qu'ils n'étaient surpassés
en nombre que par les Indiens et que seul leur dissentions chroniques
les empêchaient de devenir la plus puissante des nations. Cela
prédisposait probablement leur tendance fâcheuse à
vendre leurs services comme mercenaires ainsi que certains de leur
concitoyens en esclaves à d'autres peuples dont les Grecs. C'est
ce qui favorisa largement la propagation en Grèce des cultes
à mystères thraces comme celui de Dionysos, mais
également l'un des cultes le plus répendu chez les
Thraces - l'orphisme.
Certains d'entre eux devenaient des chroniqueurs ou des poètes,
des philosophes, mais étaient
obligés de se signer sous des pseudonymes grecs. Pourtant,
les Thraces ne semblaient
pas utiliser eux-mêmes des esclaves à l'instar des Grecs.

|
| Le
cavalier-thrace représenté sur une petite tablette de
pierre |
Depuis
leur formation, les peuples thraces ont bénéficié
d'un substrat culturel autocthone dû
à l'héritage d'une civilisation depuis longtemps
disparue, mais qui
précède celles de l'Egypte et de la Mésopotamie.
Ils ont su créer une civilisation très originale et
extêmement riche. En témoignent non seulement leur villes
nombreuses, mais également leurs temples, leur tombes avec tous
les objets de la culture matérielle et spirituelle
afférents. Ils parlaient une langue proche de celle des
Pélasges, population qui précède les Grecs et qui
habitait le Sud de la péninsule des Balkans. Leur vision du
monde était proche de celle des Scytes et des Perses. Leur
religion était dominée par le culte de la
Déesse-Mère nommée Bendida(Cybèle chez les
Phrygiens),
qui est devenue chez les Grecs Artemis. Le culte du cavalier thrace
était aussi
très répendu, attesté dans des centaines de
sanctuaires et sur des millers d'artéfacts. En Grèce il
eut pour équivalent plus tard le personnage d'Arès et
chez les Romains - Mars. L'orphisme.
était
sans doute une doctrine très répendue
prônant
la résurrection sur la base de l'héroïsme et de
l'autoperfectionnement.
Les
Thraces
Les
terres qu'habitaient les Thraces étaient approximativement
celles correspondant au
Sud de l'actuelle Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie,
le Nord de la Grèce, la partie européenne de la Turquie
et l'Anatolie. Les Thraces ont d'ailleurs amplement contribué
à l'épanouissement de la ville de Troie dont ils
formaient une partie non
négligeable de la population à certaines époques
et notamment à l'époque supposée de la Guerre de
Troie (environ 1200 av. J.-C.). Il ne fait aucun doute qu'il y avait
des Thraces parmi les dirigeants de la ville et les personnes
importantes à l'époque de Troie VII. Homère les
cite parmi ses alliés tels le roi Rhésus dont on dira
quelques mots par la suite. Le fait même que des Ethiopiens sont
cités aussi parmi ces alliés montre de
manière indirecte que c'était une guerre opposant
l'Ancien monde au Nouveau - représenté par les Grecs.
Selon une légende racontée par Hérodote dans son
livre sur l'Egypte(voir Annexe), les Phrygiens(alliés de Troie
aussi) furent considérés par les Egyptiens comme le plus
ancien peuple
au monde. Ils ont laissé des tombes sous des tumulus dans le
Nord-Est de la Grèce actuelle avant de mirgrer en Asie Mineure
ou on en trouve des tombes similaires et qui sont attestées leur
appartenir. Cependant, les Grecs les ont prétentieusement
déclarées macédoniens et ensuite, suivant la
logique de leur doctrine nationale, les ont annocées pour
grecques ! De nos jours, on connaît les noms d'environ
quatre-vingts peuples
thraces, qui étaient en réalité plus
nombreux, dont les Apsinthes, les Astes, les Besses, les Bithyniens,
les
Briges(Phrygiens) : thraco-illyriens?, les Daces, les Derses, les
Edoniens,
les Gètes, les Kikones(Cicones), les Odrysses, les Thynes, etc.
Les
villes thraces
Les
Thraces nous ont légué une toponymie très riche et
variée. Les noms de certaines de leur villes nous sont parvenus
également quasiment inchangés. Ce qui marque l'esprit au
premier abord, c'est qu'une partie non négligeable des noms de
villes se terminent toujours par les mêmes suffixes: -bria,
-para, -disa, et -dava ou bien -deva. Voici quelques exemples :
Bolbabria, Mascibria, Alebria, Poltimbria, Sombria, pour les villes se
terminant en -bria. Nous avons aussi : Dausdava, Kapidava,
Skaïdava, Breguedava, Sagadava et Pulpudeva. Cette dernière
est devenue ensuite Philipopolis, et de nos jours - Plovdiv, la
deuxième ville de Bulgarie.
Nous avons encore : Bessapara, Bussipara, Spinopara, Guelupara,
Brentopara, Basopara, pour celles dont le nom se termine en -para. Et
il nous
restent :
Turodisa, Burtudisa, Ostudisa, Rudisa et Dradisa. Il paraît que
le suffixe
-bria avait le même sens que "bourg" pour les Allemands - petite
ville, alors
que dans la langue française cela désigne plutôt un
gros village. Il est intéressant de noter que le mot thrace
"disa" trouve son équivalent en Perse et à Bactriane
où cela signifiait une forteresse. Nous avons déjà
mentionné la probabilité qu'une partie des populations
ayant pris part à la formation des Thraces soient venus d'Asie
Centrale. Parmi les noms de villes qui ne se terminent par aucun de ces
suffixes,
nous avons Serdica (l'actuelle capitale de la Bulgarie - Sofia), Beroe
(aujourd'hui
Stara Zagora), Durostorum (de nos jours Silistra), Iamforina et bien
d'autres.
Perpérikon

Nous ne passerons pas en revue toutes les villes thraces, mais nous
attirerons votre attention sur celles qui suscitent le plus
d'intérêt en ce moment aussi bien du côté
des archéologues que des touristes, car on peut
déjà visiter certaines d'entre elles. Parmi toutes
les villes thraces il y en a une qui se détache bien des
autres, non seulement parce qu'elle est chargée d'histoire,
mais aussi à cause du mystère qui l'a toujours
entourée. C'était une ville sanctuaire taillée
dans la roche, qui révèle l'activité humaine
depuis le 4e millénaire, mais dont la période
d'occupation la plus intense accompagnée par des
aménagements importants du site débute aux environs
de 1500 ans avant J.-C. Ce lieu était sacré non
seulement pour tous les Thraces, mais aussi
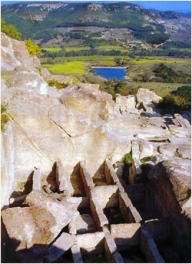 |
| Les
tombes des rois |
pour
les
Romains plus tard, et pour les chrétiens ensuite.
Alexandre le Grand et Octavius, le père d'Auguste, se rendirent
là-bas pour entendre le présage des prêtres sur
l'avenir. La
présence de la ville est attestée dans certaines
descriptions géographiques de l'Antiquité, notamment
celle de Claude
Ptolémée(2e s. après J.-C.). Ce fut la capitale du
roi thrace Rhésus. Voyons ce que dit Homère de lui par la
voix de Dolôn (Iliade,
Chant 10): "Si vous désirez entrer dans le camp des Troiens,
les Thrèkiens récemment arrivés sont à
l'écart, aux
extrémités du camp, et leur roi, Rhèsos
Eionéide, est avec eux. J'ai vu ses grands et magnifiques
chevaux. Ils sont plus blancs que la neige, et semblables aux vents
quand ils courent. Et j'ai vu son char orné d'or et d'argent, et
ses grandes armes d'or, admirables aux yeux, et qui conviennent moins
à des hommes mortels qu'aux dieux qui vivent toujours."
Le nom de cette ville est inscrit sur certaines anciennes cartes, telle
une
carte de Napoléon faite par un de ses cartographes où on
lit : "Pergamon". Pergamon fut également le nom d'une ville
grecque en Asie Mineure apparue bien plus tard et qui semble donner le
nom au parchemin(pergaminus) à cause du support à
écrire qu'on y fabriquait. La ville thrace, qui abrite un palais
royal de trois
étages datant du 5e siècle avant J.-C., se situe non loin
de la forteresse médiévale de Perpérikon, dans le
Sud de la Bulgarie,
non loin de Kârdjali. C'est pourquoi on l'a longtemps
surnommée ainsi et ce de nos jours encore. Outre le palais, le
site est muni d'une acropole, de faubourgs au Nord et au Sud, de
temples munis d'autels de sacrifices et d'une enceinte fortifiée
imposante qui date de l'époque romaine (1e - 5e siècle).
Le mot thrace "pergamus" signifiait justement ville fortifiée.
Mais ici tout a été taillé dans la roche : les
autels, les tombeaux, les systèmes de canalisation qui
fonctionnent même de
 |
| La
mine d'or |
nos jours. Certains des autels ont été utilisés
pour des sacrifices d'animaux, voire plus rarement humains. L'Acropole
est construite de gros blocs de pierre dont la jointure était
assurée uniquement par des crochets métalliques.
L'épaisseur de ses murs fait 2,8 mètres. Le palais, dont
on a découvert déjà 30 pièces, devrait
selon certaines estimations ocupper une surface totale de 1 hectar et
comporter 60 pièces. Entre le palais et l'Acropole il y a un
passage de 100 mètres creusé dans la roche,
traversé par des canaux pour conduire l'eau de pluie qui
fonctionnent toujours. Il semblerait que tout le site a
été initialement construit comme un lieu de culte,
probablement celui de Dionysos. Plus tard, le lieu s'est
développé et transformé en cité royale.
La présence d'une mine d'or et d'une rivière
orifère à proximité expliquent la richesse du
roi Rhésus et de sa capitale.
Seuthopolis
Découverte et étudiée de 1948 à 1954 lors
de fouilles de
sauvetage pendant la construction du barrage "Koprinka", dans la
région de Kazanlâk, où se situe la fameuse
"Valée des Roses" et l'ainsi nommée "Valée des
Rois thraces", la ville date de la fin du 4e siècle av. J.-C. et
a été fondée par le roi Seuthès III. Ce fut
la capitale de l'Etat odrysse. La ville fut fortifiée par une
muraille munie d'un portail au nord-ouest et d'un deuxième au
sud-ouest. Les rues se coupent suivant des angles droits. La
résidence du roi se situait au sud-est. On y a découvert
beaucoup de céramiques, de pièces de monnaie avec
l'effigie de Seuthès III, d'ornements
en argent et en bronze.

|
| Stèle
de contrat |
Un véritable évènement constitue la
découverte d'une inscription en langue grecque sur une
stèle en pierre. Les Thraces utilisaient souvent le grec
en écriture, mais ils possédaient leur propre
écriture qui reste aujourd'hui très mal connue. Le texte
est un contrat entre Bérénika -
l'épouse de Seuthès III, et ses fils, d'un
côté, et
Spartok, d'un autre côté, qui est un roi aussi, mais
à Kabilé. Selon le contrat, les descendants de
Seuthès III
s'engagent à remettre une personne - un certain
Ephémène (Epémen), qui avait été
donnée à Spartok autrefois, mais qui pour une
raison méconnue s'est retrouvée dans le temple des Dieux
samothraces à Seutopolis. Spartok de son côté
engage sa propre responsabilité pour cette personne. Il n'est
pas clair qui elle était - un prétendant au trône,
un chef de guerre ou autre. On ne parvient pas non plus à savoir
si Seuthès III était simplement abscent, gravement malade
ou décédé au moment de l'écriture du
contrat. A la fin du texte, il est fait mention qu'il est écrit
en 4 exemplaires dont deux sont déposés à
Kabilé dans le temple d'Artemis Phosphoros et sur l'agora
près de l'autel d'Apollon et les deux autres à Seutopolis
dans le temple des Dieux samothraces et près de l'autel de
Dionysos, mais qui n'ont pas été découverts par
les archéologues jusqu'à présent.
Le texte éclaire également l'état de la
religion thrace à l'époque hellénistique (de la
conquête d'Alexandre à la conquête romaine) en
montrant la forte influence grecque qu'elle subit lors de cette
période par la présence de cultes grecs à
Kabilé notamment. Mais si le culte d'Artemis, par exemple, est
grec, nous ne pouvons pas manquer de mentionnner son origine thrace -
la déesse-mère Bendida. Voici comment quelque chose qui a
été emprunté par les Grecs aux Thraces, revient
dans leur propre pays transformé et présenté comme
grec.
De nos jours on ne peut pas visiter Seuthopolis du fait que ses
vestiges gisent par 20 mètres au fond du lac formé par le
barrage "Koprinka". Un projet très audacieux de construction
d'un anneau en béton autour de la ville pour la faire resurgir
à l'air libre existe, cependant les moyens nécessaires
à sa réalisation manquent encore. Récemment, au
1er juin 2008, le Ministère de la Culture bulgare a enfin
déclaré sa faveur à la réalisation de ce
projet très original qui permettera non seulement à la
ville thrace la mieux conservée de resurgir des eaux, mais de
l'inscrire également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une
campagne pour recueillir les fonds à été
inaugurée.
Kabilé
Le nom de la ville proviendrait de Cybèle(Kibela). Elle est
située sur un plateau
à l'endroit où la rivière Tundja vire au sud, dans
le sud-est de la Bulgariе, tout
près de la ville nommée Yambol. Le plateau est
surplombé d'un acropole-sanctuaire rocheux sur lequel on a mis
à jour un relief de Cybèle. Le sanctuaire a
fonctionné entre le 2e et le 1er millénaire.
La ville est
apparue et s'est développée autour du sanctuaire vers la
fin du second millénaire. Au 5e-4e siècle av. J.-C., la
ville a entretenu des relations commerciales importantes avec les
villes grecques de l'Egée et les colonies de la côte de la
mer Noire. C'était une ville royale et une capitale. Le
sanctuaire était
utilisé également comme un site astronomique et
possède un repère Nord-Sud et Est-Ouest dont la
précision est au demi-degré d'arc. Les méthodes de
l'archéoastronomie ont permis d'établir que les
équinoxes y furent observés entre 2000 et 1500 av. J.-C.
Le relief de Cybèle qui avait une exposition
légèrement Nord-Est était éclairé
par les rayons matinaux tous les jours entre l'équinoxe du
printemps et l'équinoxe d'automne. Les points de culmination du
Soleil - le jour, et de certaines étoiles - la nuit,
permettait de suivre un jour entier au rytme d'un quart non
équitablement partagé suivant les saisons. Le site semble
avoir été utilisé jusqu'au 3e siècle av.
J.-C. Le roi thrace Spartok y taillait ses propres pièces de
monnaie à son effigie dont nombreuses ont été
découvertes par les archéologues sur le site.
Les
tombeaux et les sanctuaires thraces
Curieusement, les tombeaux nous renseignent beaucoup sur la vie, la
culture, les
croyances des gens ayant vécu en pays thrace, de par leur
architecture, de par les objets de la cuture matérielle et
spirituelle qui y étaient déposés ainsi que de par
la
décoration des parois. En Bulgarie, on a mis a jour une
quarantaines de tombeaux thraces et leur nombre ne cesse de
croître. Quinze d'entre eux possèdent une chambre
funéraire ronde, les autres étant carrées,
mais presque toutes sont munies d'une fausse voûte. Les
rondes sont couvertes par un dôme en fausse ruche. Certains
ont un corridor en
plus de la chambre funéraire et parfois
d'autres pièces.
La forme de la voûte est sans doute liée à la
religion et aux croyances thraces. Elle rapelle beaucoup les toits
coniques des maisons de l'époque. Les morts étaient
déposés entourés de tous les objets de la vie
quotidienne dont ils pouvaient avoir besoin, car les Thraces croyaient
en l'immortalité de l'âme. En ce sens leur tombeau
était leur dernière demeure et rappelle un peu une
maison. Il arrivait parfois que certains des annimaux domestiques tels
les chevaux, parfois même la femme la plus aimée, soient
mis à
mort pour les accompagner dans l'au-delà. Les Thraces
étaient polygames et les jeunes filles jouissaient d'une grande
liberté sexuelle, mais dès qu'elles devenaient
épouses d'un homme, elles étaient tenues d'une main
ferme. Il est possible que le nombre d'hommes chez les Thraces ait
été inférieur à celui des femmes, car le
métier de la guerre était considéré comme
une tâche noble chez eux. La polygamie s'est imposée dans
la culture et même dans la religion de divers peuples, comme chez
les Arabes qui, suite aux nombreuses guerres, ont manqué
d'hommes. Dans nos sociétés européennes où
le nombre de femmes est égal à celui des hommes, nous
admettons pour normal d'être monogames. Au Tibet, avant
l'invasion chinoise de 1949, une femme partageait plusieurs hommes, car
ils étaient en surnombre.
La mort chez les Thraces était considérée comme
une
libération des souffrances terrestres pour le défunt et
donnait lieu à de véritables banquets où l'on
exprimait sa joie. La naissance, au contraire, était
pleurée.
Le Tombeau de Kazanlâk
 |
| Tombeau de
Kazanlâk |
Découvert en 1944 par des soldats effectuants des travaux dans
la partie nord-est de la ville de Kazanlâk, au centre du pays, il
date du 4e siècle av. J.-C. Il fait partie d'une grande
nécropole qui se situe non loin de Seuthopolis et était
construit pour un souverain odrysse, un des rois thraces.
Son état de conservation extraordinaire avec ses peintures
murales très vivantes, qui renvoient la douceur et la souplesse
des mouvements des personnages représentés en
créant ainsi une atmosphère solennelle et intemporelle,
et d'une valeur, aussi bien archéologique que culturelle,
inestimable lui valent son inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1979. Les peintures sont exécutées suivant
la techique a fresco.
Celle-ci consiste à appliquer la peinture sur une base de chaux
frais qui au contact du gaz carbonique de l'air se transforme en
calcite et libère de l'eau. En s'évaporant, l'eau laisse
le calcite cristalliser et durcir en fixant les pigments qui
s'intègrent à la surface du mur et gagnent en
durabilité. Le peintre a utilisé le noir, le rouge, le
jaune et le blanc.
L'entrée de la tombe est situé au sud-est. La chambre
funéraire lui est reliée par un couloir(dromos) dont le
toit se termine en prisme triangulaire. La longueur du couloir est de
1,95 mètres, la largeur est 1,12 m, et au plus haut il atteint
2,24 m. L'anti-chambre est constituée par deux murs de pierres
taillées, jointes par de l'argile, des deux côtés
de l'entrée du couloir. Sa longueur est de 2,60 m et
la largeur est de 1,84 m. La chambre funéraire est en forme de
cloche. Son diamètre à la base est de 2,65 m, sa hauteur
est 3,25 m et le sommet coupé a un diamètre de 0,47 m.
Les fresques recouvrent un total d'environs
40 m2 dans le couloir et dans la
chambre funéraire. En plus de la technique a fresco, le peintre,
dont ce fut sans aucun doute l'œuvre de sa vie, a utilisé le
procédé à l'encaustique. Celui-ci consiste
à
faire fondre de la cire et à la mélanger avec des
pigments ce qui donne un certain air satiné et protège la
peinture de l'humidité de manière remarquable. Sur plus
de 2000 ans, il n'y a presque aucune craquelure. Il ne fait aucun doute
que si les Thraces étaient des apiculteurs, et savaient
prélever les rayons de miel des ruches pour en extraire le miel,
ils faisaient également un excellent usage de la cire.
Les peintures dans le couloir représentent deux armées
qui s'affrontent. Sur le côté Est, deux héros au
milieu des armées se font face. Leurs habits et leurs armements
sont traditionnels thraces - le casque phrygien, le bouclier ovale avec
des lances et la rhomphaia - une arme de taille et d'estoc dont la
lame,
à un seul tranchant, était droite ou
légèrement recourbée, d'une logueur allant de 60
à 80 cm, et dont la soie atteignait environ 50 cm, ce qui la
prédisposait à être tenue souvent à deux
mains. La rhomphaia, dans sa version dace, fut la seule arme nouvelle
rencontrée plus tard par les légions romaines qui
provoqua une modification(amélioration), attestée par
les textes, visant à mieux protéger les bras des
légionnaires. Le nom provient de la racine
indo-européenne "rump-"dans le latin "rumpo, ere",
c'est-à-dire "rompre". Sur le côté Ouest du
couloir, l'un des deux héros est agenouillé devant
l'autre. La couronne en feuilles de lauriers en or sur la tête
du défunt, repésenté dans la chambre
funéraire, ne laisse donc aucun doute sur son
héroïsation, mais également sur son rang de roi. Ce
qui marque c'est que le peintre a travaillé avec une grande
liberté d'esprit en n'obéissant à aucun sujet
classique de la peinture grecque, mais représente plutôt
des évènements historiques du monde et de la vie des
Thraces. La scène de la chambre funéraire est un festin
à la mémoire du défunt. Autour des deux
époux s'affairent des servants, des palefreniers menant de
très beaux chevaux, des musiciens, presque tous vêtus de
chitons colorés à l'avant, ceints à la taille et
sous la poitrine, et retombants par dessus les ceintures.
En plus de la maîtrise et des qualités artistiques
indiscutables du peintre, et de la très grande
originalité des sujets qu'il a représentés, nous
pouvons constater que l'art à l'époque
hellénistique ne fut point l'exclusivité des artistes et
artisans grecs. En particulier, pour ce qui concerne les Thraces, il
faut admettre qu'ils ont largement contribué au
développement et à la propagation de ce que l'on nomme
couramment "l'art hellénistique", cependant il serait plus juste
encore d'apprendre à distinguer ce qui appartient à la
culture propre de ce peuple et à ne pas systématiquement
déclarer helléniste, et par extension grec, tout ce qui a
été créé à cette époque,
comme cela se fait couramment actuellement à l'égard des
œuvres thraces, non sans arrière-pensées. Le Tombeau de
Kazanlâk possède le double avantage d'être à
la fois un chef-d'œuvre de l'art à l'époque
hellénistique et d'affirmer clairement l'existence d'un style
inimitable, d'une vision du monde artistique et humaine bien
particuliers et propres uniquement aux Thraces, et les peuples qui leur
sont apparentés. En ce sens, on peut et l'on doit parler d'un
art thrace comme une réalité coexistante et
interagissante avec le monde hellénistique et pas comme un
simple appendice à l'art grec.
Annexe
«Les
Égyptiens se
croyaient, avant le règne de Psammitichus, le plus ancien peuple
de la terre. Ce prince ayant voulu savoir, à son
avènement à la couronne, quelle nation avait le plus de
droit à ce titre, ils ont pensé, depuis ce
temps-là, que les Phrygiens étaient plus anciens qu'eux,
mais qu'ils l'étaient plus que toutes les autres nations. Les
recherches de ce prince ayant été jusqu'alors
infructueuses, voici les moyens qu'il imagina : il prit deux enfants de
basse extraction nouveau-nés !, les remit à un berger
pour les élever parmi ses troupeaux, lui ordonna
d'empêcher qui que ce fût de prononcer un seul mot en leur
présence, de les tenir enfermés dans une cabane dont
l'entrée fût interdite à tout le monde, de leur
amener, à des temps fixes, des chèvres pour les nourrir,
et, lorsqu'ils auraient pris leur repas, de vaquer à ses autres
occupations. En donnant ces ordres, ce prince voulait savoir quel
serait le premier mot que prononceraient ces enfants quand ils auraient
cessé de rendre des sons inarticulés. Ce moyen lui
réussit. Deux ans après que le berger eut commencé
à en prendre soin, comme il ouvrait la porte et qu'il entrait
dans la cabane, ces deux enfants, se traînant vers lui, se mirent
à crier : "Bécos !", en lui tendant les mains. La
première fois que le berger les entendit prononcer cette parole,
il resta tranquille ; mais ayant remarqué que, lorsqu'il entrait
pour en prendre soin, ils répétaient souvent le
même mot, il en avertit le roi, qui lui ordonna de les lui
amener. Psammitichus les ayant entendu parler lui-même, et
s'étant informé chez quels peuples on se servait du mot
bécos, et ce qu'il signifiait, il apprit que les Phrygiens
appelaient ainsi le pain. Les Égyptiens, ayant pesé ces
choses, cédèrent aux Phrygiens
l'antériorité, et les reconnurent pour plus anciens
qu'eux.»
Euterpe, Hérodote, livre
second